Si Pershing l’avait lu, il aurait poussé des cris d’orfraie et aurait crié au scandale. Le 29 septembre 1918, l’incontournable Edmond Buat couche dans son journal, une ligne aussi révélatrice que lapidaire : « l’état des forces américaines est lamentable ». Rappelons que Buat n’est pas un obscur général de division mais Aide-Major Général, soit le numéro 3 de l’Armée française. Autant dire que grâce à son poste, Buat est au courant des informations qui remontent depuis les différentes parties du front. Ici, le général français fait référence à l’Offensive « Meuse-Argonne » à laquelle les Américains participent activement mais avec des résultats bien en-deçà des espérances de Foch et Pershing. En fait, cette offensive – toujours méconnue – est marquée par une dichotomie entre la maturité tactique et technique française avec l’inexpérience des forces américaines. Et ce, alors que les forces allemandes sont nettement amenuisées.

1 – CONTEXTE STRATÉGIQUE ET OBJECTIFS
– Chez les Alliés, au regard du net avantage pris sur la Kaisersheer, quasiment tout le monde est d’esprit offensif en ce premier tiers de septembre 1918. Dans la logique des offensives roulantes de la « Campagne des Cent jours », Ferdinand Foch décide de lancer une série d’offensives coordonnée avec les armées alliées et dans un mouvement convergent vers l’axe Cambrai – Mézières. Preuve que la manière de conduire la guerre a muté, Foch ne privilégie plus une seule portion du front mais regarde l’ensemble de la ligne. Si l’on doit reprendre une image sportive, alors que Ludendorff cherchait à donner un coup direct décisif, Foch frappe son adversaire des pieds et des mains, de face comme dans les flancs. Au début du mois de septembre, Foch consulte tout le monde. Comme le rapporte Edmond Buat, les Britanniques sont enthousiastes. Foch s’entretient avec le Lieutenant-General Sydney Clive (Chef de la mission militaire britannique à Paris) qui l’assure de l’entière coopération de Haig. Le 8 septembre, le Coordinateur en chef réunit les Généraux Cyriaque Gillain (chef d’état-major de l’Armée Royale de Belgique) et Herbert Plumer (Second Army) qui l’assurent égalent de leur entière participation. En revanche, comme nous l’avons vu, les négociations sont plus âpres avec Pershing qui réclame son offensive américaine contre le saillant de Saint-Mihiel avant de participer à l’offensive finale. Foch accorde à son allié de lancer une offensive contre Saint-Mihiel mais est contraint de repousser son grand jeu au 26 septembre (1).
– Pour ne pas laisser les Allemands souffler, Français, Britanniques, Belges et Américains doivent frapper le front allemand dans un séquence d’offensives les 26 et 27 septembre. Ainsi, les forces du BEF attaqueront la portion de la Ligne « Hindenburg » qui protège le Canal du Nord, de même que la « Wotan-Stellung » qui couvre la ligne Quéant – Drocourt (entre Arras et Valenciennes) ; l’Armée Belge et la Second Army une poussée en direction de Passchendaele et Gheluveld ; le Groupement d’Armées de Réserve de Fayolle (Ire et IIIe Armées françaises) effectuera une poussée vers le nord est depuis l’Oise et la Vesle en direction de Saint-Quentin ; le Groupe d’Armées du Centre (Ve et IVe Armées française ; First US Army) attaquera depuis une ligne comprise entre Suippes-Mourmelon et la Forêt du Mort-Homme, soit dans un secteur quadrillé par l’aire et la Meuse.
– Dans l’idée du coordinateur en chef des Armées alliées, il ne faut pas laisser aux Allemands un instant de répit. Ainsi, Américains et Français l’attaque en Argonne qui doit être lancée le 26 septembre, vise à frapper le Heeres-Gruppe « Gallwitz » et la droite du HG « Kronprinz » par une poussée convergente en direction de la Ligne Mézières – Sedan. La finalité vise à saisir le nœud logistique allemand de Mézières, en concordance avec l’offensive britannique sur l’axe Arras – Cambrai – Mézières (First et Third Armies) et contre le Canal de Saint-Quentin (Fourth Army), comme avec l’offensive du Groupe d’Armées de Réserve (GAR) d’Emile Fayolle qui vient de franchir l’Aisne et la Vesle se rapprochant de Laon (Xe et VIe Armées), tout en convergeant vers Saint-Quentin (Ire Armée). L’offensive « Meuse – Argonne » doit donc être déclenchée juste après celle des Britanniques contre les Canaux du Nord et de Saint-Quentin. Pour les Alliés, frapper sur cet axe présente un avantage certain : séparer en deux le dispositif militaire allemand dans le nord-est de la France, c’est-à-dire isoler Mézières et Sedan de Metz. Et par le même coup, couper la liaison entre le Heeres-Gruppe « Kronprinz » (QG à Sedan) et le Heeres-Gruppe « Gallwitz ».

2 – LA PRÉPARATION ALLIÉE : ENTRE SÉRIEUX ET PRÉCIPITATION
– Américains et Français engagent de puissants effectifs pour cette offensive mais curieusement, en comparaison de la liquidation du Saillant de Saint-Mihiel, l’Offensive réunit une nette supériorité numérique en hommes (1,2 millions) mais une proportion inférieure en chars et artillerie, pour un front plus étendu (environ 40 km). Ainsi, on compte 480 chars, 840 avions et 2 780 pièces d’Artillerie. En comparaison, l’Offensive sur Saint-Mihiel comptait 386 chars, 1 140 avions et 3 010 bouches à feu (). Curiosité de l’histoire, les Américains comptent dans leurs rangs une unité de 850 travailleurs venus… du Royaume du Siam.
1 – Les Français
– Pour les opérations, Français et Américains partagent donc le premier rôle. Victorieuses en Champagne depuis juillet, les forces françaises placées sous le commandement du Général Paul Maistre (Groupe d’Armées Centre) doivent effectuer une puissante poussée vers le nord, à partir d’une ligne qui s’étend du Front de la Suippes jusqu’à la lisière ouest de la Forêt d’Argonne. Grand, sec, taciturne mais respecté par ses soldats, rendu manchot par une grave blessure reçue aux Dardanelles, Henri Gouraud peut se targuer d’une nette victoire. En effet, le 15 juillet 1918, il a brillamment remporté la Quatrième Bataille de Champagne et mis en échec l’Offensive « Friedensturm ». Cette fois-ci, il a le rôle d’attaquant mais peut compter sur la solidité et la motivation de ses troupes.

– Le rôle principal de l’offensive française sera joué par la IVe Armée française du Général Henri Gouraud doit percuter les forces allemandes entre la Suippes (secteurs de Tahure, Somepy et Perthes-les-Hurlus) et la lisière occidentale de la forêt d’Argonne. Les Français (qui comptent d’ailleurs le 369th US Infantry Regiment afro-américain dans leur rang) doivent franchir l’Aire, la Dornoise et le cours supérieur de l’Aisne pour remonter en direction de Savigny, Vouziers et Attigny. Enfin, en appui de la IVe Armée, la Ve Armée de Henri-Mathias Berthelot lancera des attaques plus limitées dans au nord de la Montagne de Reims afin d’y retenir l’aile droite de la III. Armee allemande.

– Cependant, il faut souligner les notables différences de terrains dans lesquels Français et Américains devront attaquer. Les premiers attaqueront dans la Champagne crayeuse et aux frontières de l’Argonne, une région marquée par les combats de 1915 et de juillet 1918. Il s’agit d’une vaste étendue vallonnée formée par de vastes champs en openfield. S’ils permettent plus facilement de manœuvrer et de coordonner les efforts aviation – forces terrestres, ses champs ouverts offrent les soldats français au viseur des Allemands. De leur côté, les Américains attaqueront en Argonne, une région vallonnée, parsemée de forêts qui permettent aux Allemands de se cramponner solidement au terrain. Et les bois ont pour inconvénient de rendre les fantassins invisibles aux avions, ce qui peut nuire à la coordination entre unités.

De gauche à droite : les Généraux Louis Prax, Noël Garnier-Duplessix et Edme Philippot
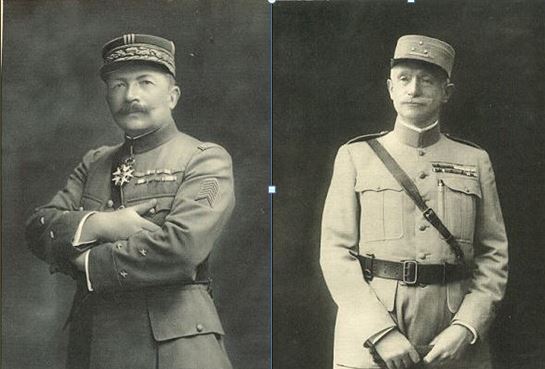
2 – Les Américains
– La First US Army doit nettoyer le Massif de la Forêt d’Argonne et attaquer sur la ligne qui part de l’est de cette même forêt jusqu’à la Meuse. Après le nettoyage du massif forestier, les Américains doivent pousser leur effort vers le nord en direction de Sedan, franchir l’Aire et atteindre la Canal de Bar, tout en reprenant Bayonneville, Buzancy et Raucourt. L’autre poussée – celle de l’aile droite américaine (I Corps) – doit s’effectuer de part et d’autre de la Meuse dans le secteur de Montfaucon et de la crête qui porte son nom.
– Pour les Américains, attaquer dans l’Argonne met en relief plusieurs problèmes. Premièrement, la géographie et l’environnement. L’Argonne est parsemée de forêts, de vallons et de cours d’eau. Ensuite, le secteur est resté très calme depuis les derniers combats pour le Crête de Vauquois (1915). Du coup, les Allemands en ont profité pour renforcer leurs défenses « en dur ». D’autre part, l’état-major de Pershing, davantage occupé à la préparation de l’Offensive de Saint-Mihiel, n’a pas eu le temps suffisant de récolter assez d’informations sur les défenses allemands, ni de planifier sérieusement son offensive. Du coup, Pershing décide de lancer un assaut frontal. Mais George C. Marshall, chef des opérations, a la lourde tâche de déplacer des unités lourdes vers l’Argonne et relever la IIe Armée française du Général Hirschauer. Mais pour les Américains, cela tourne vite au cauchemar en raison de l’encombrement des routes. Or, c’est la première fois que l’AEF doit déplacer, par lui-même, de telles forces. Quand les divisions américaines étaient subordonnées aux Français, ceux-ci coordonnaient leur déplacement et leur installation. Mais pour l’Argonne, les Américains ne se montrent absolument pas à la hauteur de la tâche et le déploiement des unités se fait des conditions chaotiques (2). Et sur ce point, le Colonel Rémy Porte et l’historien britannique Peter Hart se rejoignent clairement.

– Du coup, afin de conserver le rythme offensif souhaité par Foch, Pershing donne un ordre simple à ses commandants de Corps : marcher tout droit et enfoncer les trois lignes de défense allemande par un simple assaut frontal. L’ordre que donne Robert J. Bullard (commandant du III US Corps) à ses chefs de divisions est éloquent : « marcher tout droit, sans vous se préoccuper des divisions voisines et conserver une réserve seulement pour sécuriser vos flancs (3) ». Mais il y a encore plus grave. Certaines divisions américaines (telles les 35th, 77th et 79th) viennent à peine de sortir du camp d’instruction. Et celle-ci est parfois incomplète. Peter Hart met en avant l’exemple du Private Horace Baker (77th US Division) qui raconte « ne pas savoir complètement se servir de son FM Chauchat » (4).
– En outre, s’ils savent déployer de puissants moyens matériels pour une offensive, les Américains ne sont pas encore totalement familier des tactiques de combat complexifiées dont Français et Britanniques se sont faits les spécialistes. La formation pour les combats de tranchée est encore insuffisante et arrivés en ligne le 25 septembre, de nombreux « Doughboys » ne se sont toujours pas familiarisés au maniement de certaines grenades ou explosifs. Ajoutons également que la logistique. Les propos du Major-General Robert Alexander, commandant de la 77th US Division, sont tout proprement stupéfiants. Cet officier, peu au fait de la guerre moderne, estime que les armes lourdes d’infanterie (canon de 37 mm, mitrailleuses et mortiers légers) ne sont que d’intérêt limité pour les assauts d’infanterie. Et il ajoute qu’il vaut mieux compter sur la « fiabilité du fusil Springfield M 1903 (5) ». Tout officier français ou britannique de grade équivalent à cette période de la guerre, aurait pu s’étrangler en entendant ces mots. Autre exemple, la 35th US Division du Major-General McClure (qui a été « vampirisée » de nombre de ses officiers qui furent remplacés par de nouveaux sans expérience) reçoit pour l’offensive, l’appui des 142 chars de la 1st US Tank Brigade de Patton (dont quelques lourds et peu maniables Schneider). Les deux unités ont pour mission de franchir l’Aisne à l’est de la forêt d’Argonne. Mais comme le fait encore remarquer Peter Hart, la coopération entre les états-majors de deux formations et tout bonnement inexistante. Seulement, après Saint-Mihiel, le parc américain en chars s’est amenuisé. Et de plus, les Britanniques n’ont pas voulu céder de tanks lourds aux américains, leur parc ayant été réduit depuis le 8 août (6).

– Pour l’Artillerie, on observe également de grosses lacunes quant à la coopération avec l’aviation et la planification des feux, ainsi que la coopération étroite avec l’Infanterie. Dans certaines divisions, les lacunes sont si graves, que les Français doivent « prêter » plusieurs de leurs officiers aux Américains pour les conseiller sinon les rectifier. Foch a même ordonné à Hirschauer de céder plusieurs régiments d’artillerie à Pershing. Ainsi, la 77th US Division d’Alexander reçoit le renfort de 6 batteries de canons de 75 mm, ainsi que 1 de 155 CTR. Mais comme le note Peter Hart, les Américains sont assez déboussolés devant le savoir-faire français (7).
– C’est donc dans une nette précipitation et avec une formation imparfaite ainsi qu’une préparation bâclée, que les Américains vont se lancer à l’assaut de l’Argonne. A Saint-Mihiel, Pershing avait vu sa tâche facilitée par l’amorce du repli allemand. Mais pour l’Argonne, la tâche va s’avérer beaucoup plus dure.

3 – POINT SUR LES FORCES ALLEMANDES
– Inutile, là encore, de revenir sur l’état de décrépitudes qui caractérise les unités de la Kaisersheer à ce moment de la guerre. Et le HG « Kronprinz », tout comme le HG « Gallwitz » n’y coupent sûrement pas. Quasiment toutes les divisions sont réduites à 50 % de leur effectif total. C’est encore pire pour la 117. ID qui ne compte que 3 300 hommes. Le moral varie suivant les unités allemandes. Ainsi, les divisions qui ont servi sur le front de l’Est conservent encore un moral assez élevé, ce qui n’est guère le cas des divisions ayant servi sur le Front de l’Ouest.
– Le dispositif défensif des Allemands est scindé en trois lignes :
1 – « Giseler-Stellung » : Les deux pentes de la Butte de Montfaucon – Vallée de l’Aire
2 – « Kriemhielde-Stellung » : 15 km derrière « Giseler » ; couvre Grandpré – Romagne – Brieulle-s/-Meuse.
3 – « Freya-Stellung » : environ 8 km derrière « Kriemhilde » ; sensée couvrir la voie ferrée Sedan – Mézières.
– Face aux Français de Gouraud sur le front compris entre Suippes et Massiges, le HG « Kronprinz » dispose des restes squelettiques de la III. Armee de Karl von Einem (15 divisions) qui a été sévèrement étrillée lors de la Quatrième Bataille de Champagne (juillet 1918). Enfin, le secteur compris entre l’est de al Forêt d’Argonne et le Mort-Homme est tenu par la V. Armee de Georg von der Marwitz. Cette grande formation est scindée entre le General-Kommando 58 d’Alfred von Kleist et le Maas-Gruppe West (issu du XXI. Armee-Korps) d’Ernst von Oven.
[Suite]
(1) BUAT Gén. Ed. : « Journal de Guerre 1914-1923 », GUELTON Col. Fr. & SOUTOU G-H. (Prés.), Perrin, Ministère de la Défense, 2015
(2) PORTE Lt. Col. R. : « Les Américains dans la Première Guerre mondiale. Une approche française », SOTECA, Paris, 2017
(3) HART P. : « The Last Battle. Victory, defeat and the end of World War I », Oxford University Press, 2018
(4) HART P., Op. Cit.
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) Ibid.
